
Gabrielle Grondin-Gravel, Chargée de projet – Municipalité inclusive, Espace MUNI

Entrevue avec Saïd Hebbat, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, en communication informatique adaptée, CISSS Montérégie Centre, Institut Nazareth et Louis-Braille
Et si, d’ici 2050, l’intelligence artificielle (IA) devenait un véritable levier d’inclusion pour les personnes vivant avec une déficience visuelle? C’est le pari que fait Saïd Hebbat, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle et technologies adaptées. Dans cette entrevue, il nous présente sa vision d’une société plus inclusive… et d’un avenir municipal intelligent.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre expertise dans le domaine de l’IA appliquée aux personnes ayant une déficience visuelle?
S. H. : Diplômé à la maîtrise en réadaptation en déficience visuelle de l’Université de Montréal, je travaille principalement avec une clientèle adulte, généralement entre 18 et 61 ans. Je me spécialise en communication adaptée, qui couvre l’informatique, la lecture, l’écriture et les technologies d’assistance.
Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les personnes ayant une déficience visuelle dans leur vie quotidienne, particulièrement dans les espaces publics?
S. H. : La déficience visuelle touche plusieurs aspects de la vision, comme l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision des couleurs et la sensibilité à l’éblouissement. On distingue généralement les personnes non voyantes et celles qui ont encore une vision fonctionnelle.
Ces limitations entraînent des situations de handicap dans plusieurs sphères, notamment la communication, l’éducation, l’emploi, le déplacement et l’accès à l’information. Dans les services publics, ça peut se traduire par l’incapacité de naviguer sur un site Web non accessible, la difficulté à se déplacer dans un bâtiment mal éclairé ou sans signalisation adaptée ou à lire un document imprimé.
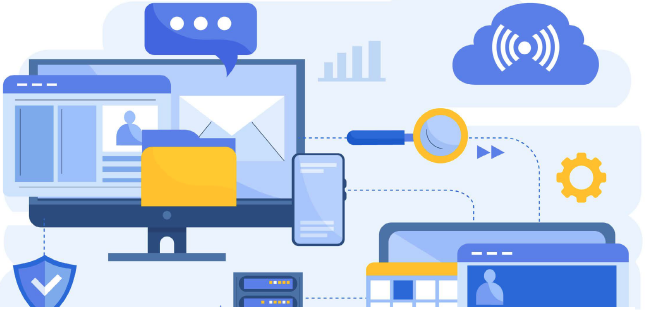
Comment l’IA peut-elle jouer un rôle pour surmonter ces obstacles?
S. H. : L’IA peut vraiment jouer un rôle clé. En réadaptation, elle est utilisée pour compenser, améliorer ou faciliter l’autonomie. Ainsi, certaines applications permettent de lire des documents, de décrire l’environnement, de reconnaître des visages ou de guider les déplacements. Ce sont des outils concrets qui peuvent transformer la vie quotidienne.
Selon vous, de quelles façons les municipalités peuvent-elles intégrer ces technologies dans l’espace public?
S. H. : Il y a un potentiel énorme. Un exemple serait l’intégration d’un dialogueur intelligent (chatbot) sur
le site Web d’une municipalité pour faciliter l’accès à l’information. L’IA peut également être utilisée pour concevoir des systèmes de guidage dans des lieux publics, comme les bibliothèques, les centres aquatiques et les théâtres.
Y a-t-il des risques ou des défis à surveiller?
S. H. : Le prix élevé de ces technologies constitue un obstacle. Il existe aussi un risque de dépendance à ces technologies pour accomplir les activités de la vie quotidienne. En cas de panne ou d’indisponibilité, il est essentiel que les personnes conservent des habiletés de base.
Et, bien sûr, il y a des enjeux éthiques. On traite souvent des données sensibles. Quand une personne utilise une IA pour lire son courrier, par exemple, il existe des risques pour la protection de ses données personnelles.
Dans 25 ans, à quoi pourrait ressembler une ville véritablement intelligente et inclusive?
S. H. : C’est une question complexe! On pourrait imaginer une municipalité où les personnes vivant avec une déficience visuelle peuvent accéder à tous les services à distance, être guidées partout et interagir avec des agents conversationnels.
Toutefois, il faudra aussi veiller à préserver le lien humain, à ne pas tout confier à la technologie. L’IA est là pour aider, non pour remplacer. Il faut donc trouver un équilibre sain entre efficacité numérique et interaction sociale.
